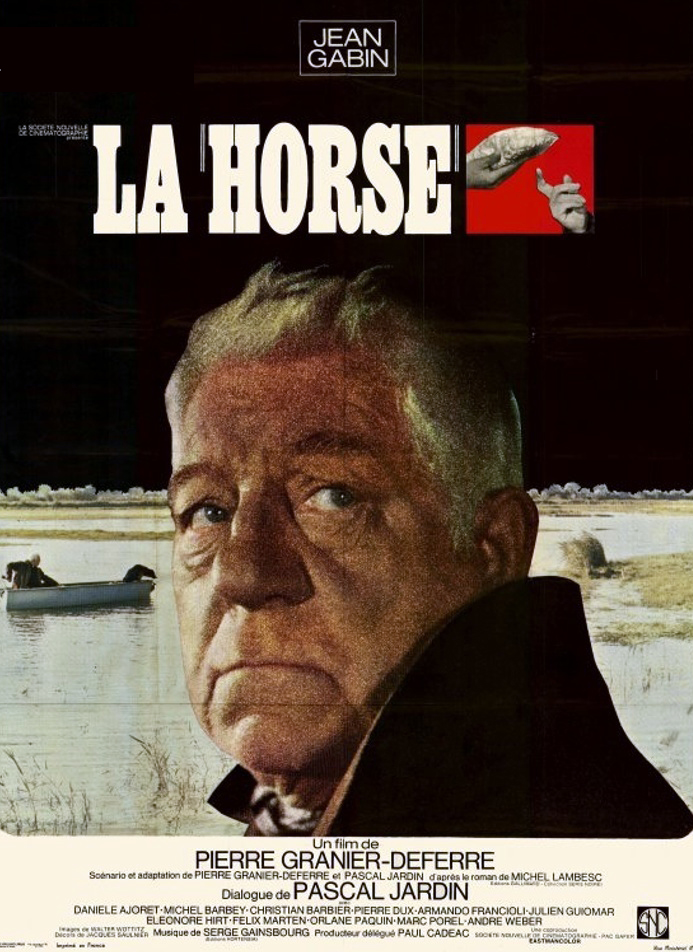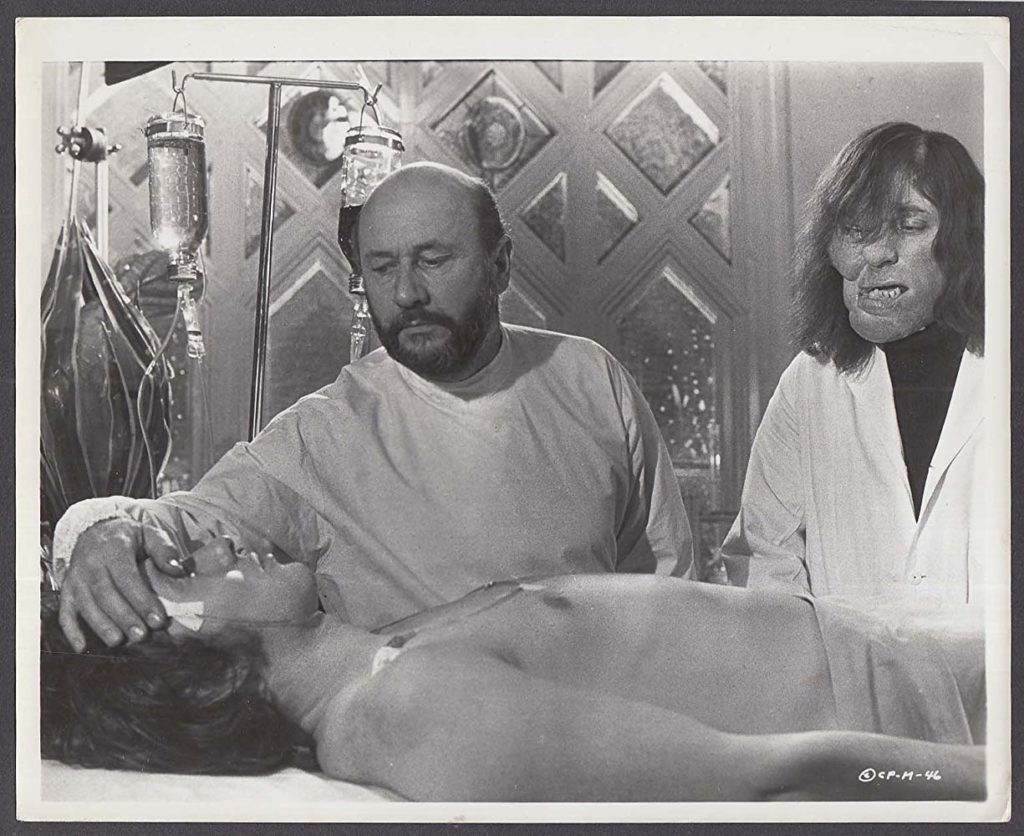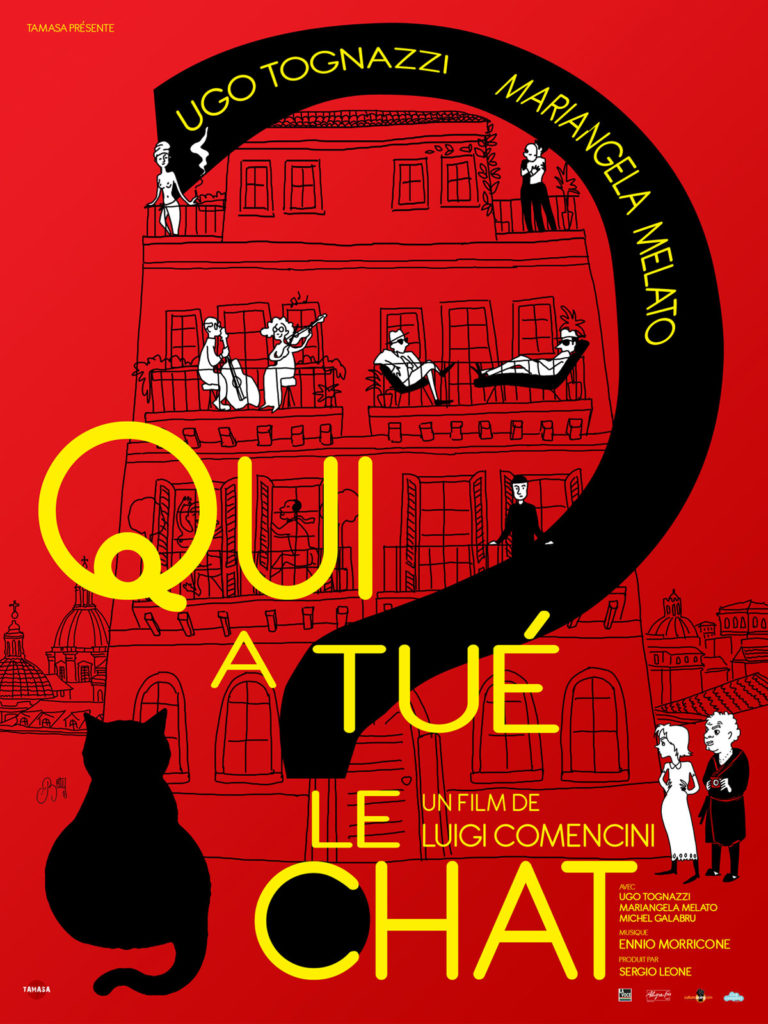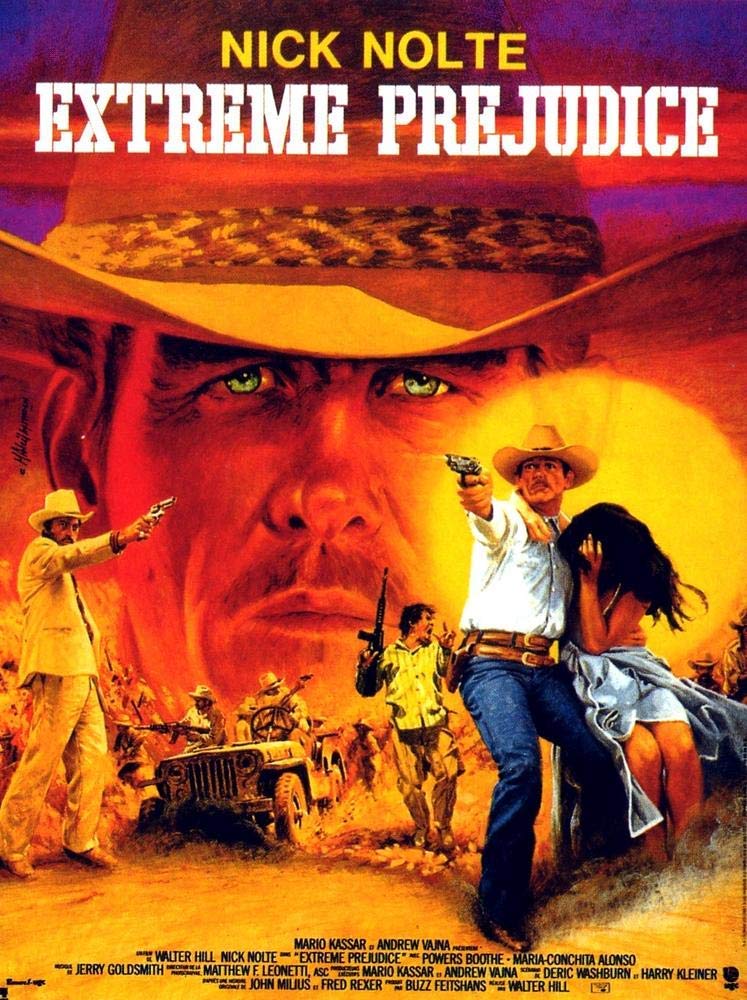LA MANDARINE réalisé par Edouard Molinaro, disponible en DVD et Blu-ray depuis le 23 mai 2018 chez LCJ Editions
Acteurs : Annie Girardot, Philippe Noiret, Madeleine Renaud, Murray Head, Marie-Hélène Breillat, Jean-Claude Dauphin, Robert Berri, Madeleine Damien, Nane Germon, Pippo Merisi…
Scénario : Christine de Rivoyre, Édouard Molinaro d’après le roman éponyme de Christine de Rivoyre
Photographie : Claude Lecomte
Musique : Claude Bolling
Durée : 1h28
Date de sortie initiale : 1972
LE FILM
Séverine et Georges dirigent un hôtel de luxe, rue de Rivoli, dont Mémé Boule, une alerte vieille dame, est propriétaire. A la mort de leurs parents, Mémé Boule a adopté Séverine et ses deux frère et soeur jumeaux, Alain et Baba. De l’un de leurs nombreux voyages, Alain et Baba ramènent un écrivain anglais qu’ils installent à demeure. Le séduisant jeune homme a tôt fait de séduire Baba, Mémé Boule et Séverine elle-même, pourtant tout d’abord réticente…

Du cinéaste Edouardo Camille Molinaro alias Edouard Molinaro (1928-2013), nous connaissons surtout ses immenses succès populaires, Oscar (plus de six millions d’entrées), La Cage aux folles (5,4 millions), Hibernatus (3,4 millions), L’Emmerdeur (3,3 millions), La Cage aux folles 2 (3 millions), Mon oncle Benjamin (2,7 millions) ou bien encore Une ravissante idiote (2,2 millions). Au cours de sa longue carrière, le réalisateur aura attiré près de 50 millions de spectateurs dans les salles françaises. Pourtant, Edouard Molinaro n’a jamais caché que les films qui lui étaient le plus cher et le plus personnel étaient ceux dissimulés dans l’ombre. Au début des années 1970, après le triomphe de Mon oncle Benjamin, le cinéaste désire s’éloigner quelque peu du cinéma commercial et retrouver une veine plus intimiste. Ce sera le cas de La Liberté en croupe (1970) et Les Aveux les plus doux (1971), deux films atypiques et résolument d’auteur, qui ne rencontrent cependant aucun succès à leur sortie. Qu’à cela ne tienne, bien décidé à continuer dans cette voie, Edouard Molinaro jette son dévolu sur un roman de Christine de Rivoyre publié en 1957, La Mandarine, qu’il adapte avec l’écrivaine elle-même. Ecrit bien avant 1968, La Mandarine annonçait alors les revendications féministes sociales et culturelles qui exploseront à l’aube des années 1970. Sa transposition à l’écran s’inscrit donc dans l’air du temps et offre au réalisateur un terrain de jeu dans lequel il aborde la liberté sexuelle, la bourgeoisie repliée sur elle-même, ainsi que la jeunesse éphémère et l’envie de bouffer la vie, à travers une histoire d’amour passionnée et avec une liberté de ton rare et insolite dans le paysage cinématographique français.