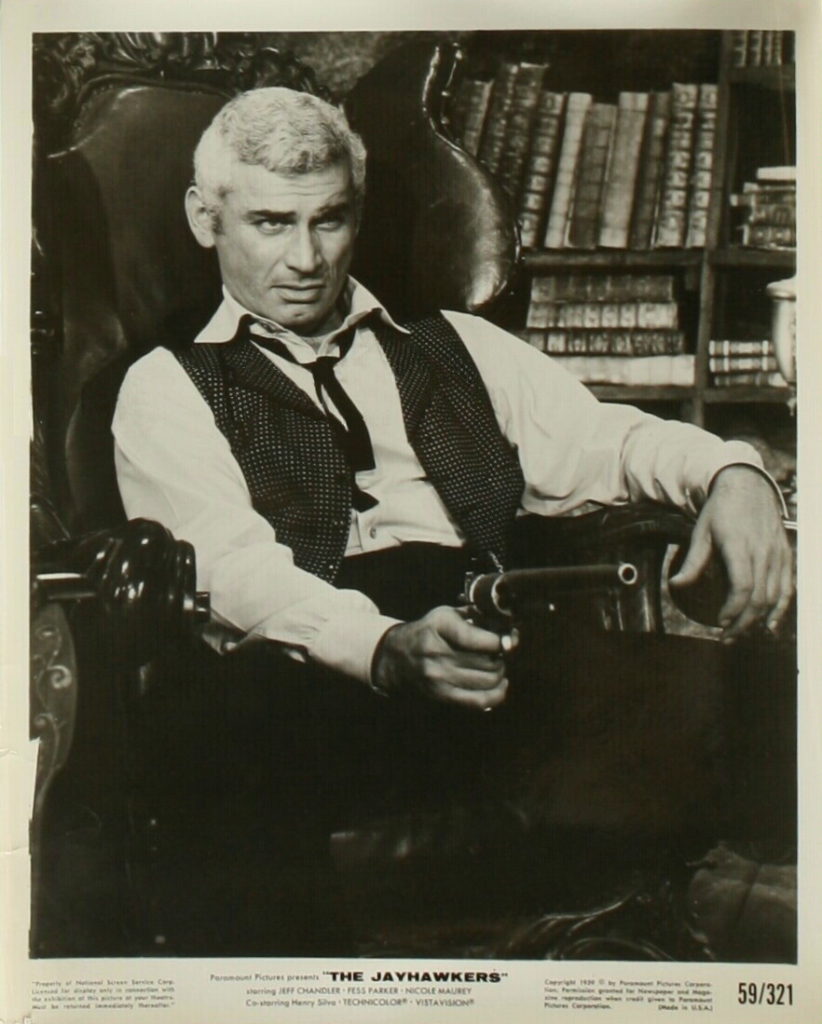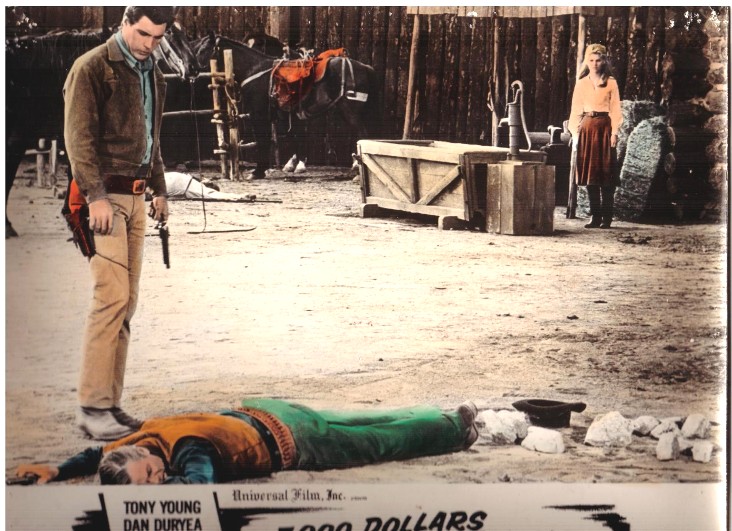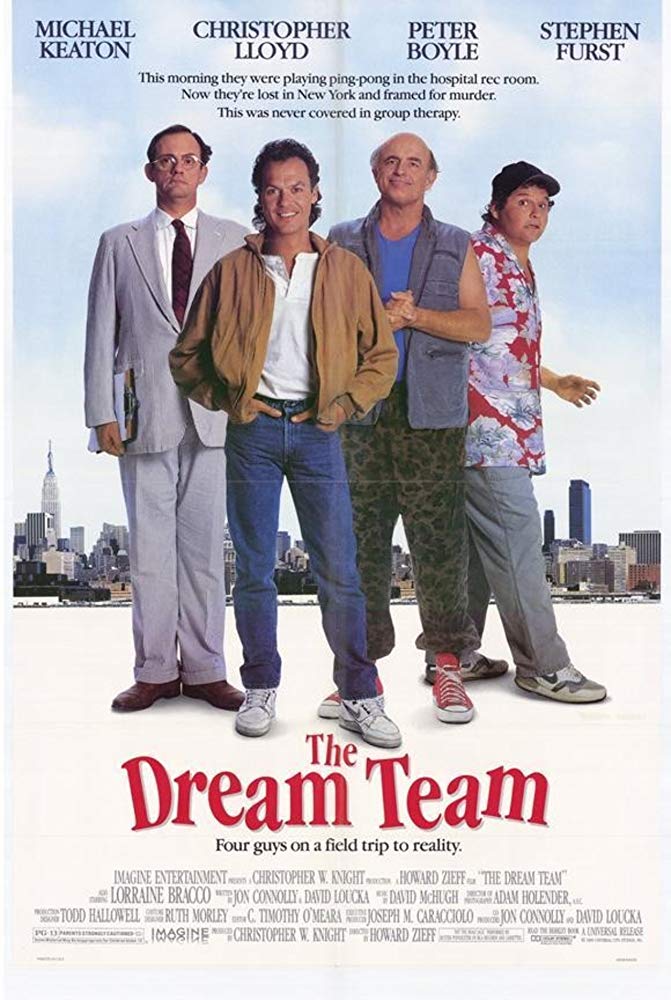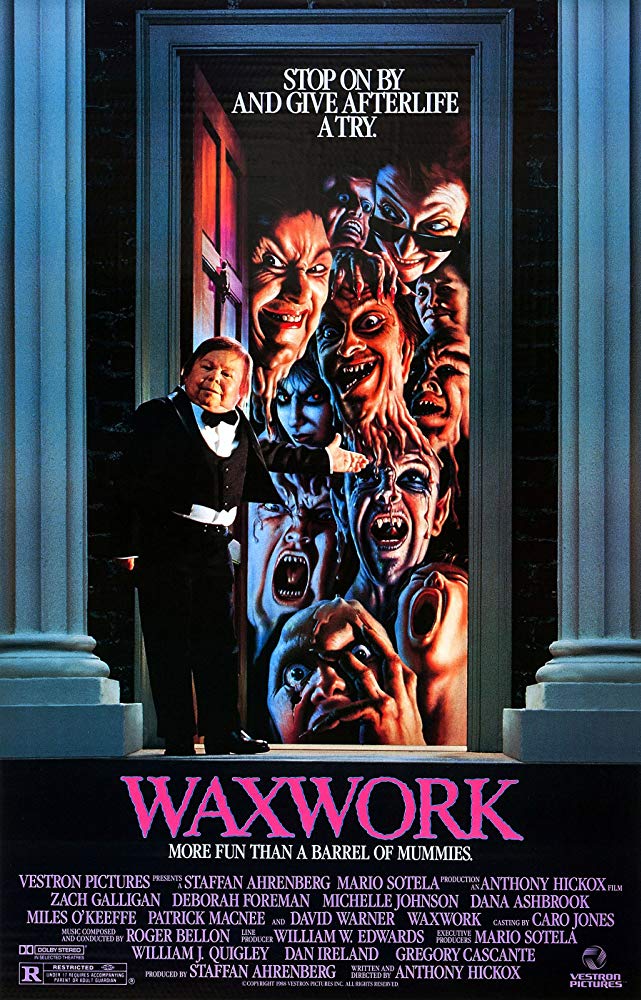RAMBO : LAST BLOOD réalisé par Adrian Grunberg, disponible en DVD et Blu-ray le 25 janvier 2020 chez Metropolitan Vidéo
Acteurs : Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal, Óscar Jaenada, Rick Zingale, Fenessa Pineda, Louis Mandylor, Jessica Madsen…
Scénario : Matthew Cirulnick, Sylvester Stallone d’après le personnage créé par David Morrell
Photographie : Brendan Galvin
Musique : Brian Tyler
Durée : 1h41
Date de sortie initiale : 2019
LE FILM
Cinquième épisode de la saga Rambo.
Vétéran de la Guerre du Vietnam, John Rambo va devoir affronter un cartel mexicain.

Il y a onze ans, nous laissions John Rambo revenir chez lui, se dirigeant vers un ranch au bout d’un chemin poussiéreux, après son retour de Birmanie. La conclusion de la saga et l’opus John Rambo (ou simplement Rambo en version originale) étaient en tout point parfaits. Quelle ne fut pas l’étonnement de la part des fans de Sylvester Stallone, quand le comeback du plus célèbre des Bérets Verts a été annoncé par le comédien ! S’il s’agit clairement d’une « cerise sur le gâteau », Rambo : Last Blood, titre qui indique clairement qu’il s’agit bel et bien de l’ultime baroud d’honneur de son protagoniste en faisant référence au tout premier épisode réalisé par Ted Kotcheff, First Blood (1982), n’était franchement pas espéré, mais puisque le film existe, pourquoi s’en priver ?