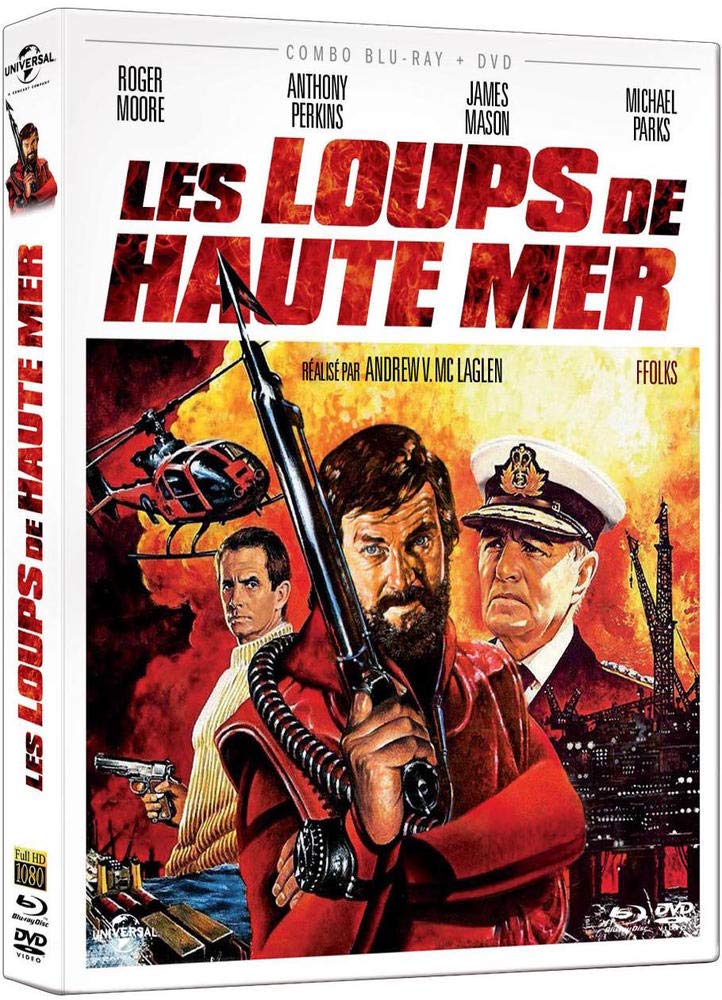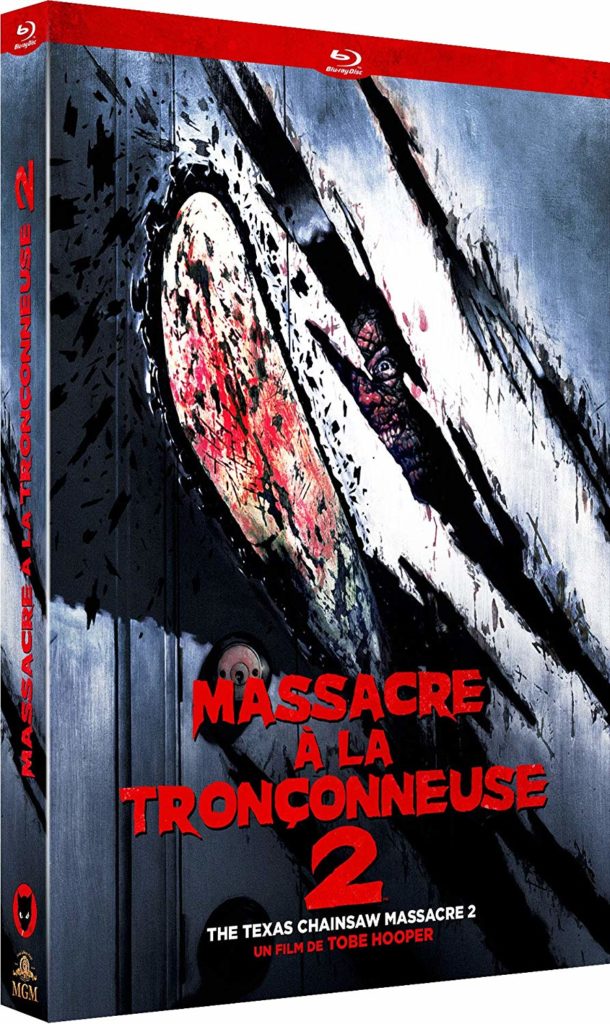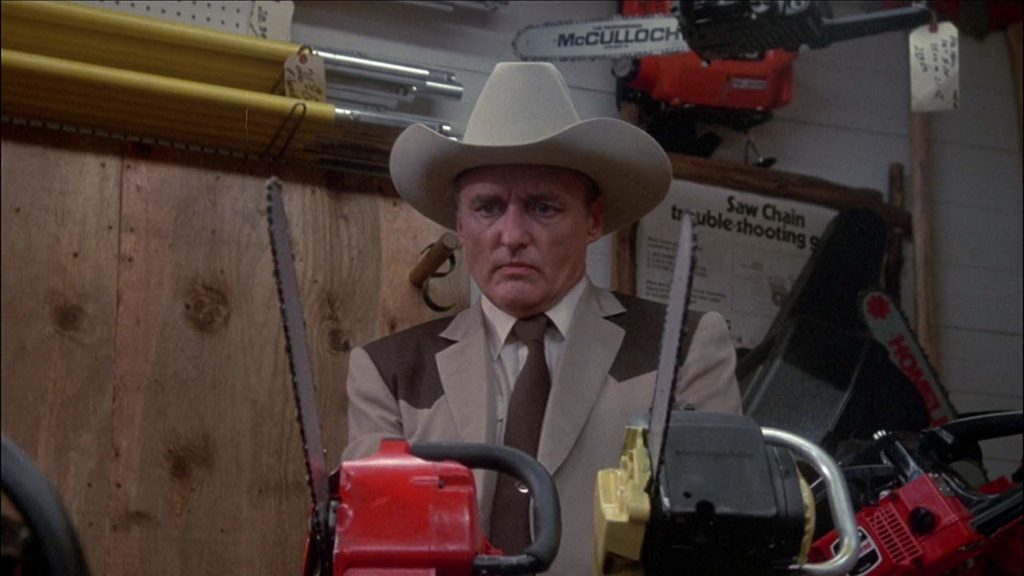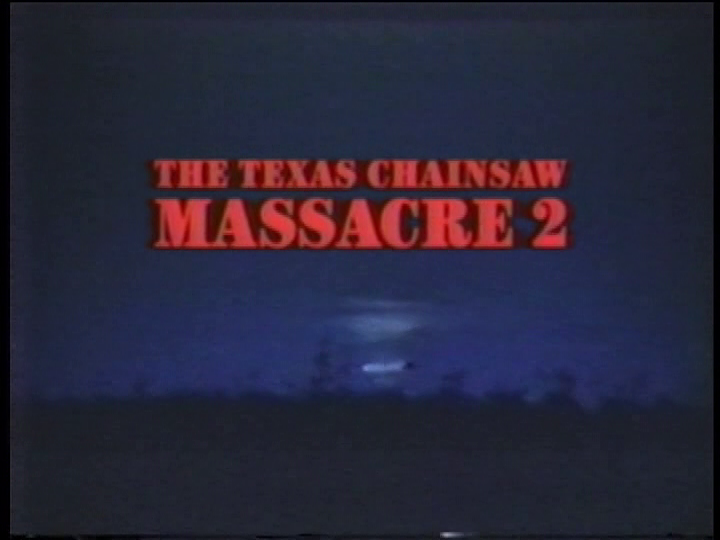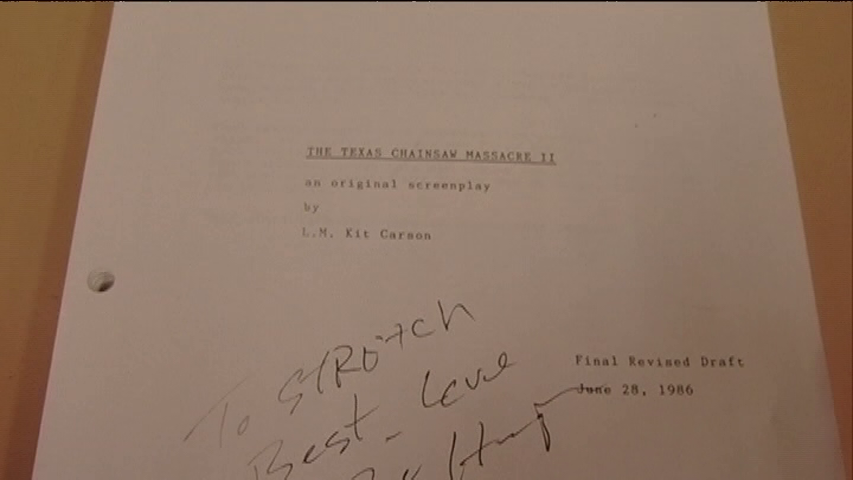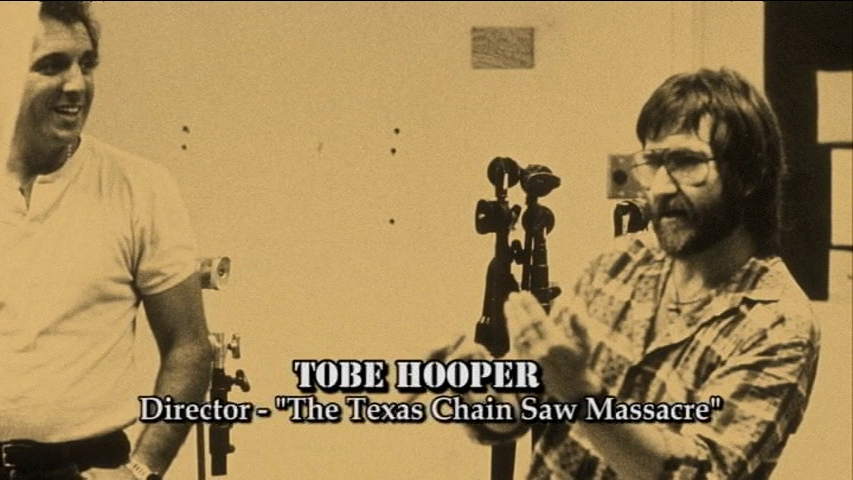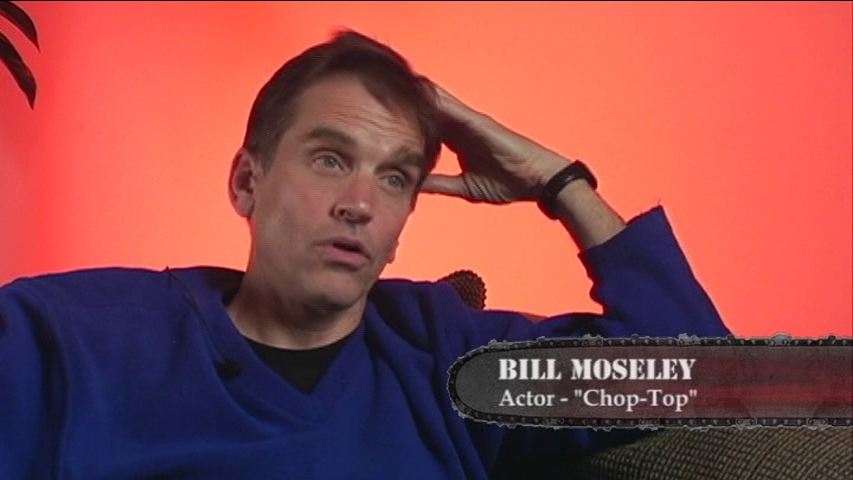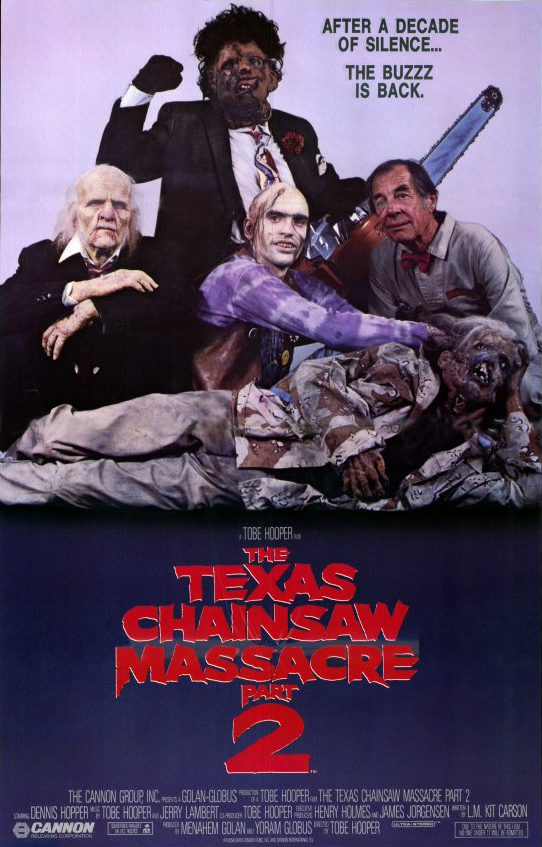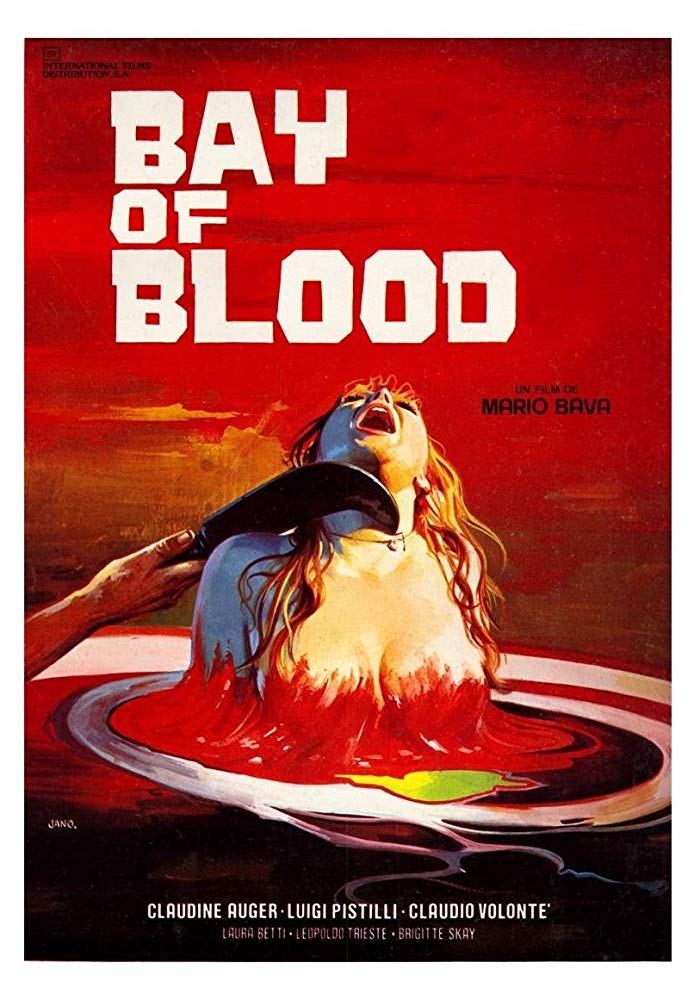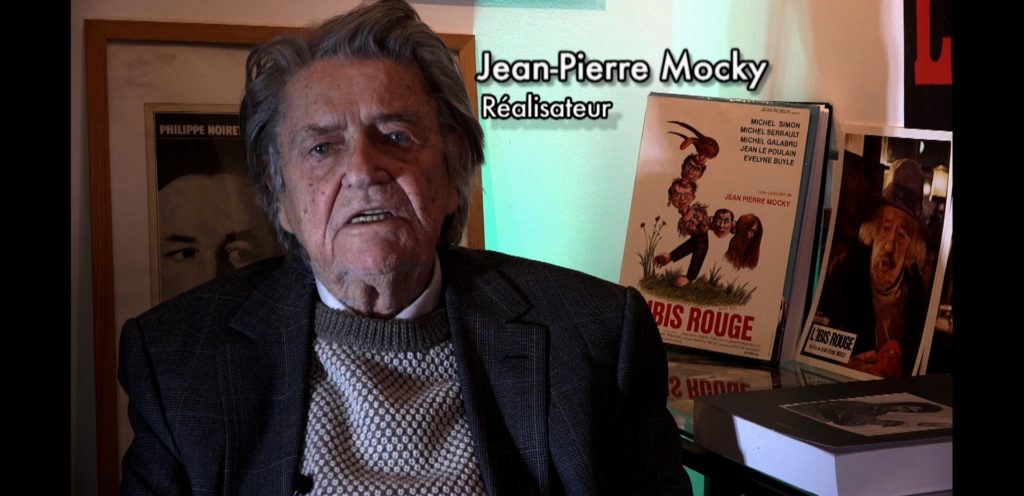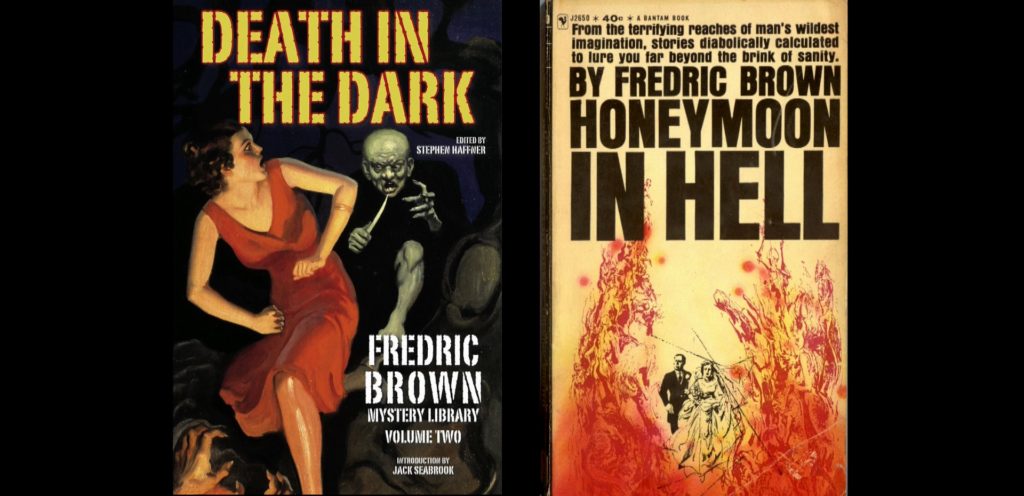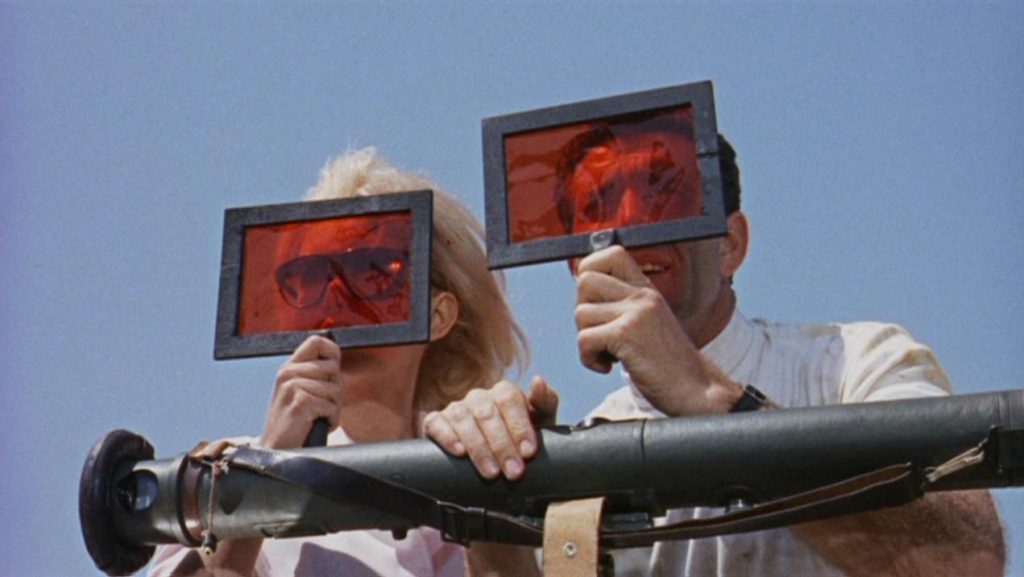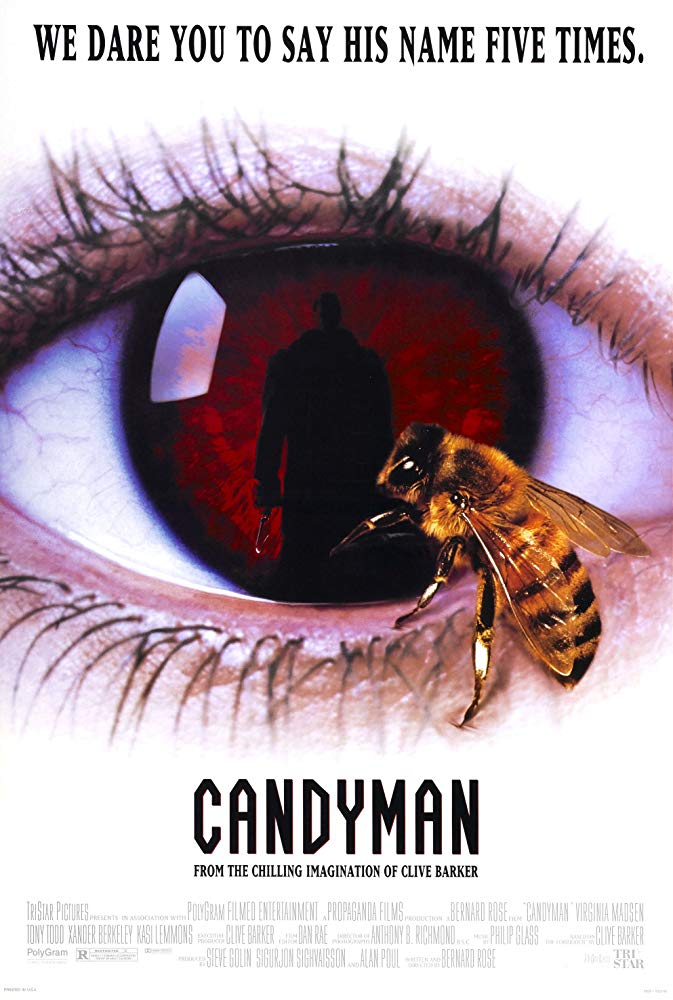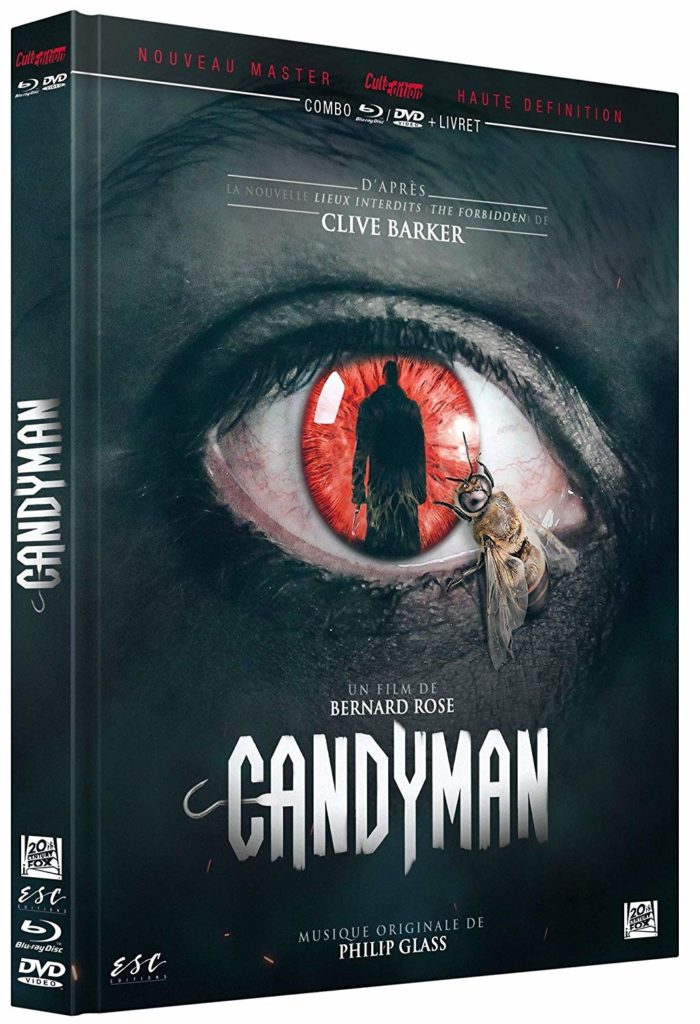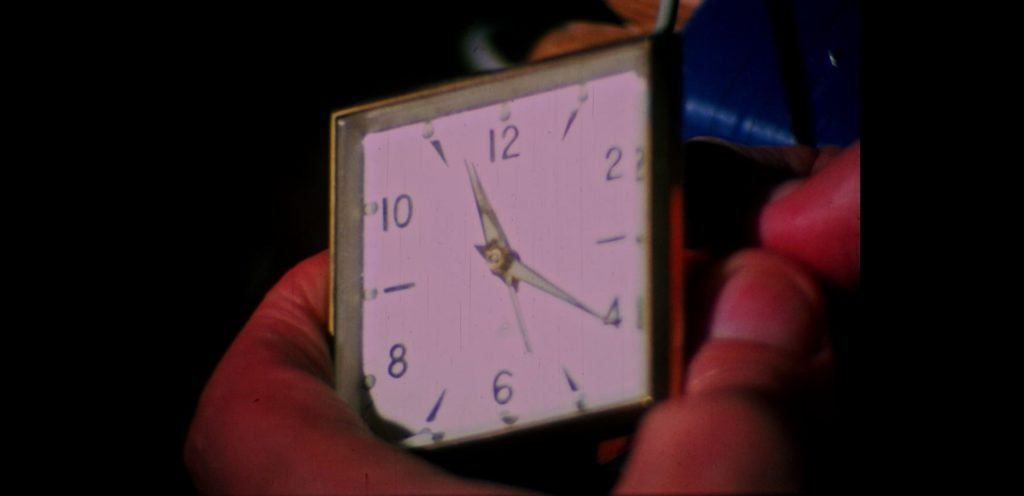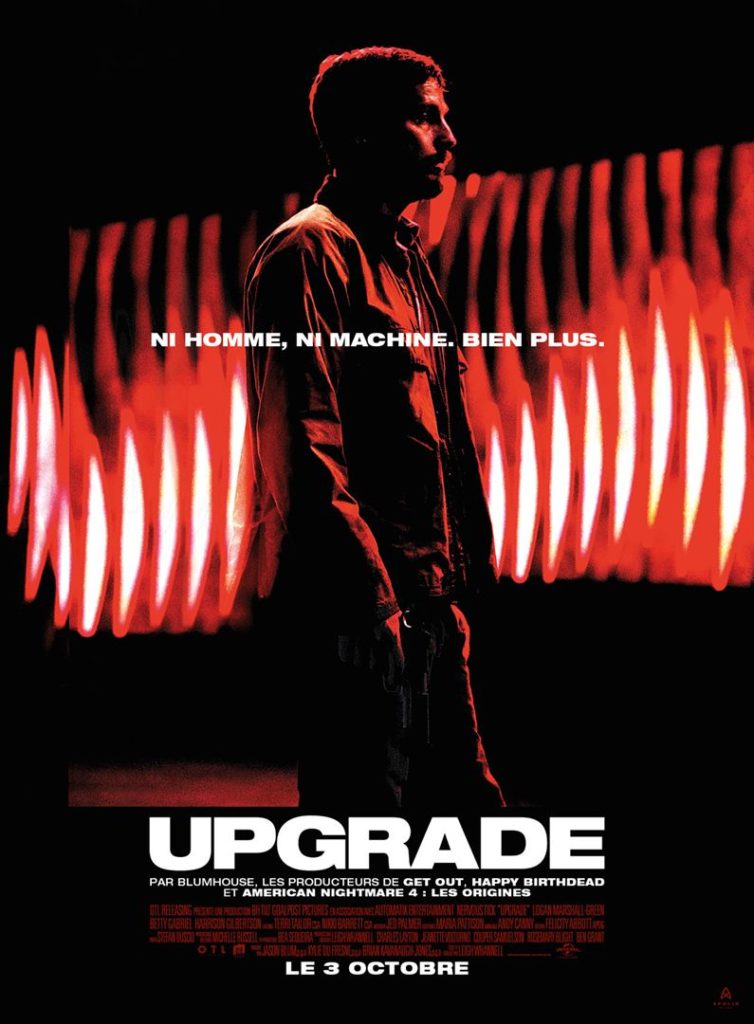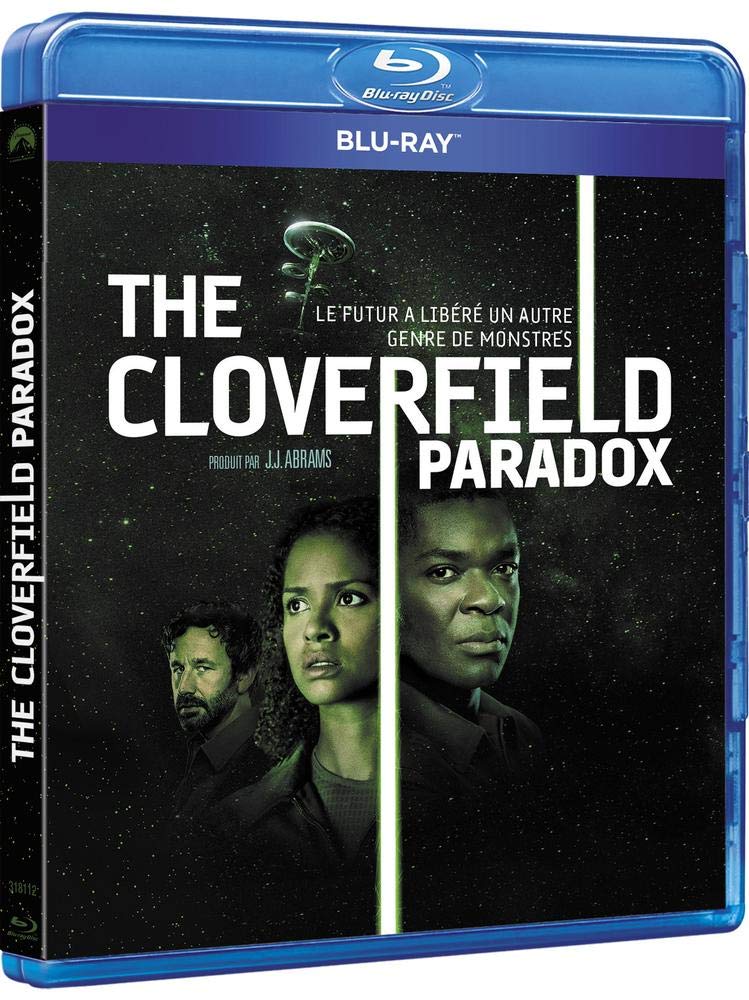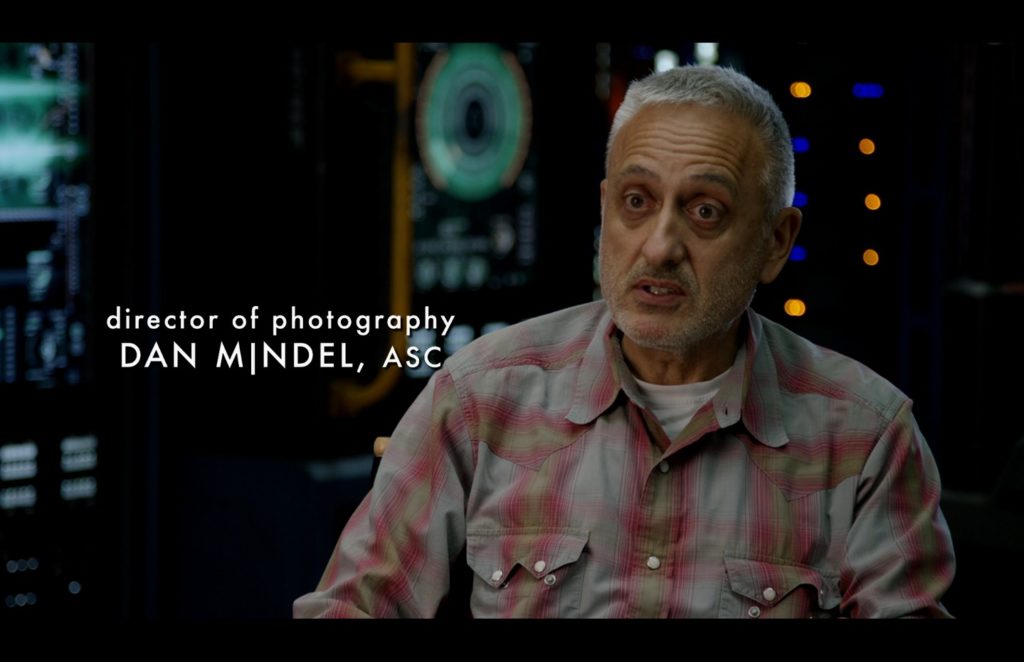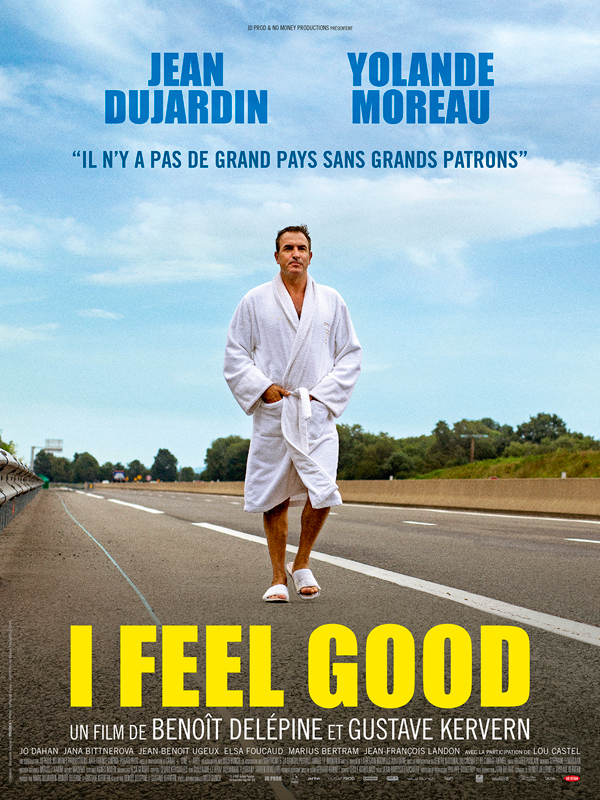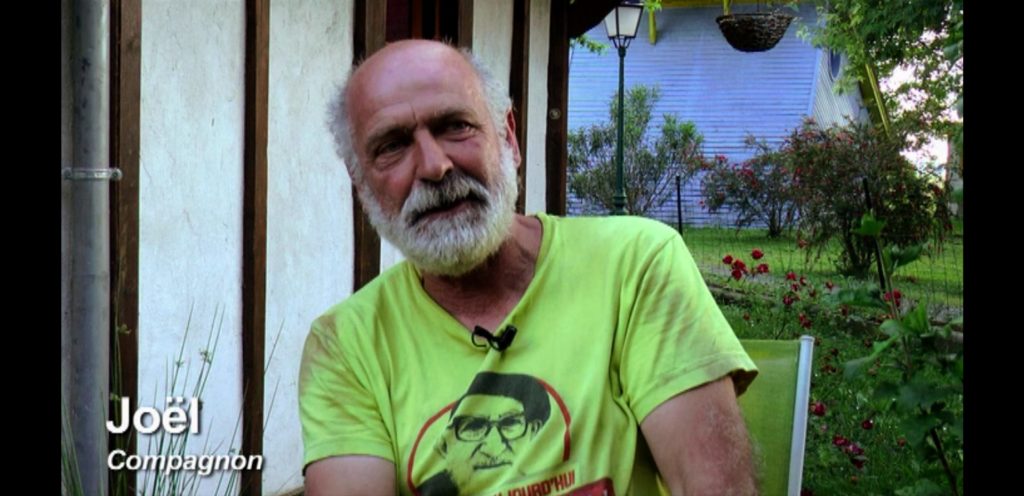AMANDA réalisé par Mikhaël Hers, disponible en DVD chez Pyramide Vidéo le 2 avril 2019
Acteurs : Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Marianne Basler, Jonathan Cohen, Nabiha Akkari, Greta Scacchi…
Scénario : Mikhaël Hers, Maud Ameline
Photographie : Sébastien Buchmann
Musique : Anton Sanko
Durée : 1h47
Date de sortie initiale : 2018
LE FILM
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Mikhaël Hers. Si ce nom ne vous dit rien, il s’agit pourtant d’un de nos plus précieux cinéastes. Né en 1975, le réalisateur fait ses débuts derrière la caméra en 2006 avec Charell, moyen-métrage magnifiquement interprété par Jean-Michel Fête et Marc Barbé, librement adapté d’un des chapitres du roman De si braves garçons de Patrick Modiano. Mikhaël Hers y abordait déjà quelques-uns de ses thèmes de prédilection avec la rencontre de deux anciens amis d’enfance, que les hasards de la vie avaient fini par éloigner. Au détour des rues désertes d’un quartier perdu, les nuits se succèdent, faisant alors ressurgir le spectre d’un passé lointain. Charell posait les bases d’un univers singulier, mettant en valeur un Paris by night et la nostalgie d’une amitié aujourd’hui oubliée ou lointaine. Présenté à Cannes en 2006 dans le cadre de la Semaine Internationale de la Critique, ce surprenant coup d’essai allait être rapidement suivi de Primrose Hill. L’action se situait à l’Ouest de Paris, dans une petite ville de banlieue bordée par la Seine, où quatre amis d’adolescence se retrouvaient pour tenter d’enregistrer les maquettes de nouvelles chansons. Ce deuxième moyen-métrage sera en réalité la première esquisse de son premier long métrage, Memory Lane. Une fois de plus, la ville de Paris est aperçue des collines de la banlieue ouest, l’hiver est rude, une personne a visiblement disparu et sert de narratrice. Le groupe déambule sans but réel, les protagonistes parlent de tout et de rien (en apparence), une nostalgie est déjà palpable chez ces jeunes de 25 ans, tiraillés entre les adolescents qu’ils étaient quand ils se sont connus, et les adultes qu’ils sont devenus malgré eux.
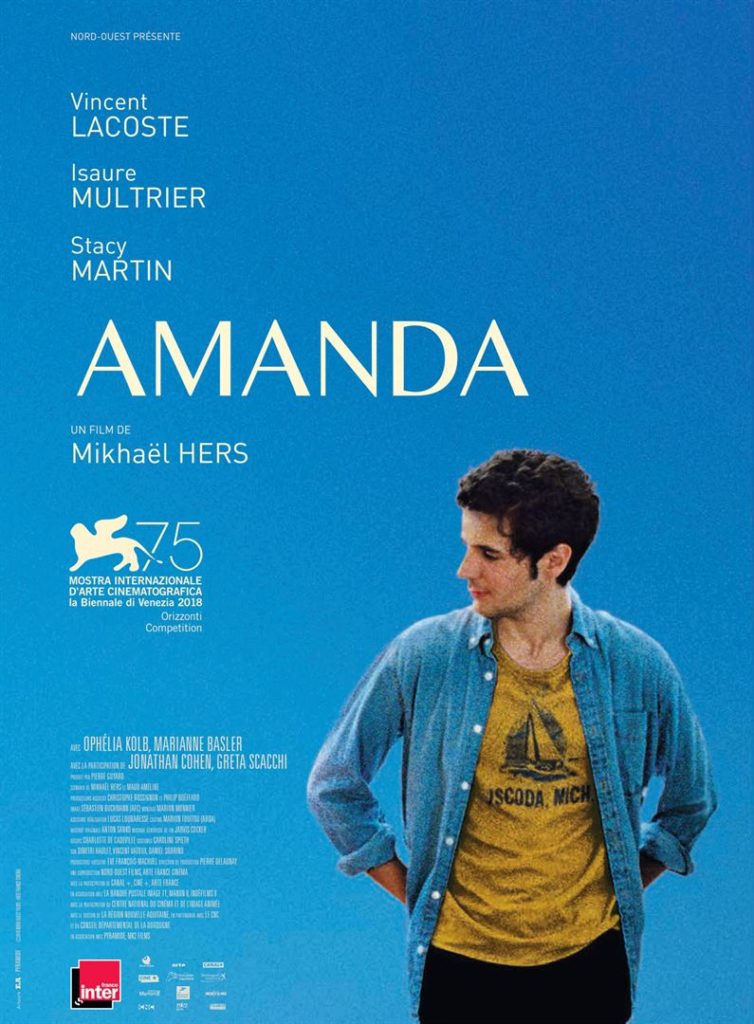

En 2009, Mikhaël Hers réalise le sublime Montparnasse, véritable typhon d’émotions, qui se déroule une nuit dans le quartier de Montparnasse à Paris avec pour décor le néon des boulevards, quelques rues désertées, une galerie marchande, un jardin endormi, le parvis de la tour. Portrait de trois jeunes femmes de 25 ans, le film prend la forme du film à sketchs, tout en respectant une unité de lieu et de temps. Avec une rare sensibilité qui renverse complètement le spectateur dès la première partie, Montparnasse clôt une trilogie débutée avec Charell mettant en relief des conversations nocturnes, des retrouvailles, une disparition et la douleur qu’elle engendre, les désillusions post-adolescentes, le mal-être, le souvenir d’une jeunesse récemment envolée, l’angoisse existentielle. Sorti sur les écrans en août 2010, Memory Lane était un vrai coup de maître, confirmé en 2015 par Ce sentiment de l’été. Nous voilà donc rendu à Amanda, le troisième long métrage du cinéaste. Et c’est toujours aussi merveilleux. Avec délicatesse, sobriété et élégance, Amanda impose une fois plus son auteur, mais aussi son comédien, Vincent Lacoste, probablement l’acteur le plus passionnant de l’année 2018.


Il incarne ici David, vingt-quatre ans, un jeune homme qui cumule les petits boulots et profite de la vie, tout en écartant les décisions importantes d’une vie. Mais, un jour, il apprend la mort de sa sœur aînée et se retrouve à devoir s’occuper de sa petite nièce de sept ans, Amanda.


Pour le cinéaste et producteur Luc Moullet, Mikhaël Hers se rapproche de cinéastes tels que John Ford ou Agnès Varda (paix à son âme), quant à son rapport à l’espace. Depuis Ce sentiment de l’été, le réalisateur, qui avait pour habitude de se servir du cadre de la banlieue Ouest de Paris pour décor, avec notamment la terrasse du Parc de Saint-Cloud, a élargi son champ d’action. Après Berlin, Paris et New York dans son précédent long métrage, Mikhaël Hers revient à Paris (11e, 12e, 19e et 20e arrondissements) dans Amanda et s’en va faire également un tour à Londres, dans les parcs situés en banlieue. Dans Amanda, le travail sur la lumière estivale est toujours aussi important, tout comme les conversations en apparence anodines. A l’instar de Ce sentiment de l’été, Amanda traite du deuil après une disparition injuste et inattendue. Dans son troisième long métrage, le cinéaste prend pour toile de fond les attaques terroristes, en imaginant un attentat dans le bois de Vincennes, durant lequel Sandrine, la sœur du personnage principal, mais aussi Léna, sa nouvelle petite-amie sont victimes de ces attaques. Si la seconde (superbe Stacy Martin) parvient à s’en sortir, la première (délicate Ophélia Kolb) décède des suites de ses blessures. David (Vincent Lacoste, sublime), doit alors prendre en charge la fille de Sandrine, Amanda, sept ans, avec tous les bouleversements que cela entraîne chez ce jeune homme de 24 ans, mais aussi chez cette petite fille.


Nul autre que Mikhaël Hers est à ce point capable de capturer le Paris contemporain. Avec sa patine argentique et ses couleurs fanées, Amanda montre une capitale fragilisée par les attentats, comme si ses habitants marchaient sans cesse sur un fil. Plus ancré dans le présent et le quotidien que ses précédents films, Amanda foudroie le coeur à chaque instant et rappelle parfois le somptueux Ponette (1996) de Jacques Doillon. On s’attache immédiatement aux personnages, dont la jeune Isaure Multrier, étonnante, spontanée et très prometteuse dans le rôle-titre. Bouleversant, et pourtant solaire, optimiste et sans aucun misérabilisme, Amanda fait partie de ces films qui ont la grâce, qui restent dans la tête et dont les personnages reviennent fréquemment en mémoire avec l’envie de savoir ce qu’ils sont devenus.


LE DVD
Le test du DVD d’Amanda, disponible chez Pyramide Vidéo, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est animé et musical.
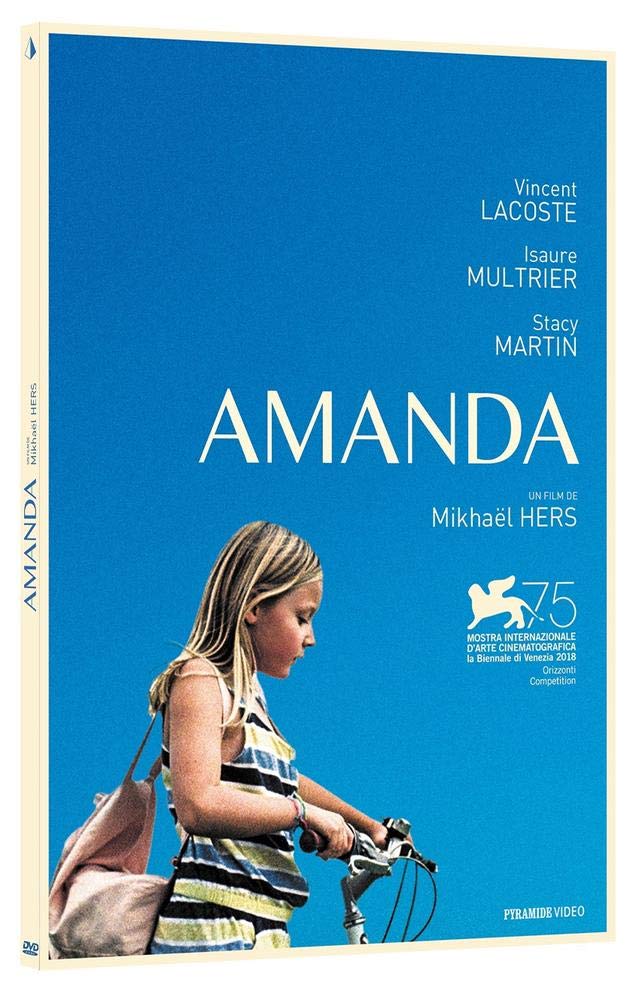
A l’instar des suppléments de Ce sentiment de l’été, l’interactivité présente sur le DVD d’Amanda se résume à peu de choses.
On appréciera la vidéo du casting d’Isaure Multrier (7’30), où la petite de 9 ans fait déjà preuve d’une étonnante maturité. Ce module montre également la première fois où Isaure donne la réplique à Vincent Lacoste.


La musique a toujours tenu une place importante dans l’oeuvre de Mikhaël Hers. L’éditeur propose d’écouter la bande-originale signée Anton Sanko, ainsi qu’un titre inédit de Jarvis Cocker, Elvis has left the building (23’30).

L’interactivité se clôt sur un lot de bandes-annonces, dont celle du Festival International du film de Bordeaux, réalisée par Mikhaël Hers pour l’édition 2016.

L’Image et le son
Amanda bénéficie d’un transfert suffisamment propre et clair, correspondant à la découverte du film dans les salles. Visiblement filmé avec les éclairages naturels, la colorimétrie se révèle volontairement terne voire parfois délavée, et le manque de définition est aussi aléatoire qu’inhérent aux conditions des prises de vue. Les contrastes sont soit trop appuyés soit trop légers, les visages manquent de précision, tout comme le piqué trop émoussé. Les volontés artistiques du réalisateur, avec un grain plus ou moins appuyé, sont donc bien restituées…




S’il ne fait pas d’esbroufe inutile, le mixage Dolby Digital 5.1 demeure néanmoins timide sur les latérales. Cela est d’autant plus dommage que la musique est assez présente dans Amanda et qu’on pouvait s’attendre à une spatialisation agréable. Si les surround déçoivent même pour ce qui concerne le rendu des ambiances naturelles, les frontales sont en revanche dynamiques, les dialogues sont solidement posés sur la centrale. Pour des conditions de visionnage parfaites, optez néanmoins pour la stéréo, beaucoup plus fluide et homogène que son homologue 5.1 avec une balance gauche-droite ardente et un rendu musical actif. L’éditeur joint également une piste Audiodescription, ainsi que les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant.