
LA MALÉDICTION WINCHESTER (Winchester : The House that Ghosts Built) réalisé par Michael & Peter Spierig, disponible en DVD et Blu-ray le 3 juillet 2018 chez TF1 Studio
Acteurs : Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook, Eamon Farren, Angus Sampson, Tyler Coppin, Laura Brent, Finn Scicluna-O’Prey…
Scénario : Tom Vaughan, Michael Spierig, Peter Spierig
Photographie : Ben Nott
Musique : Peter Spierig
Durée : 1h40
Année de sortie : 2018
LE FILM
Proche de San Francisco se situe la maison la plus hantée au monde : construite par Sarah Winchester, riche héritière de l’entreprise d’armes Winchester, elle est en perpétuelle construction et contient des centaines de pièces. Sarah y construit une prison, un asile pour les centaines d’esprits vengeurs tués par ses armes, et le plus terrifiant d’entre eux veut en découdre avec sa famille…

Les frères jumeaux Spierig (nés en 1976), Michael et Peter, n’ont décidément pas de chance. Chef d’oeuvre absolu, leur troisième long métrage Prédestination (2014) n’a connu qu’une exploitation en DVD et Blu-ray en France. Laissons le temps faire son œuvre pour que ce film incroyable trouve enfin son public et soit considéré à sa juste valeur. Après avoir repris en main la franchise Saw avec le dernier opus en date Jigsaw, retour à la case e-cinema et DTV pour leur nouveau bébé, La Malédiction Winchester – Winchester : The House that Ghosts Built. Cette fois encore, dommage de ne découvrir ce film autrement qu’au cinéma où il aurait dû avoir sa place, surtout lorsque l’on regarde la qualité des trois quarts des productions de genre qui squattent continuellement les écrans.



La Malédiction Winchester est un excellent film fantastique inspiré de la vie de Sarah Winchester, épouse et veuve de William Wirt Winchester, fils d’Oliver Fischer Winchester, ingénieur et inventeur des fusils qui portent son nom, devenus le symbole de la Conquête de l’Ouest. A la mort de son époux et de leur fille, Sarah Winchester hérite de ses biens et de 50 % des parts de la Winchester Repeating Arms Company. Tombée dans une profonde dépression, convaincue que des esprits allaient la tuer, Sarah Winchester utilise sa fortune pour poursuivre de manière ininterrompue, 24 heures sur 24, la construction de son immense demeure pendant 38 ans. Depuis sa mort, la très étendue Mystérieuse Maison Winchester est devenue un monument historique national et une attraction touristique, connue pour ses nombreux escaliers et couloirs ne menant nulle part, ainsi que ses 160 pièces, 40 chambres, 17 cheminées, placards sans fond. Les frères Spierig et leur coscénariste Tom Vaughan partent de ce postulat pour imaginer une histoire de maison hantée, en jouant sur l’extraordinaire et hallucinante architecture de la bâtisse située en Californie à San José. Un merveilleux terrain de jeu idéalement exploité par les cinéastes, qui prouvent une fois de plus leur talent pour instaurer un climat angoissant, tout en livrant un objet plastiquement très recherché.



Le film démarre par le sempiternel panneau « Inspiré de faits réels » et repose en effet sur le sort qui semblait s’acharner sur Sarah et sa famille, mais aussi sur cette maison étrange bâtie dans le but d’enfermer tous les esprits des personnes tuées par la carabine qui a fait la fortune des Winchester. Les travaux continueront de jour comme de nuit, selon les plans établis par Sarah, retirée dans son salon privé, comme si certaines apparitions la guidaient pour établir les futures extensions. Ce qui frappe d’emblée dans La Malédiction Winchester, c’est la beauté de la photographie de Ben Nott, chef opérateur et fidèle collaborateur des frères Spierig qui happe les spectateurs. A cela s’ajoutent les incroyables décors et dédales dans lesquels on se perd volontiers et mis en valeur par les réalisateurs australiens qui instaurent une ambiance réaliste à leur récit, sans avoir recours gratuitement aux jump-scares.



La malédiction Winchester n’est pas un film d’horreur, mais un drame et thriller fantastique qui comporte un message intelligent sur l’usage abusif des armes aux Etats-Unis, ainsi que sur leurs répercussions. Ou comment user du folklore pour en tirer une histoire divertissante et excellemment interprétée par Helen Mirren, parfaite Sarah Winchester, Jason Clarke, vecteur du public pour le faire entrer dans ce labyrinthe hanté, sans oublier Sarah Snook, révélation de Prédestination. Tous ces talents sont réunis pour un divertissement de haute qualité, parfaitement mis en scène (malgré un budget très limité de 3,5 millions de dollars), flatteur pour les mirettes et qui réserve son lot d’émotions fortes, tout en interrogeant sur le sang versé par les armes à feu. Une très grande réussite.



LE BLU-RAY
Le test du Blu-ray de La Malédiction Winchester, disponible chez TF1 Studio, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est très légèrement animé et musical.
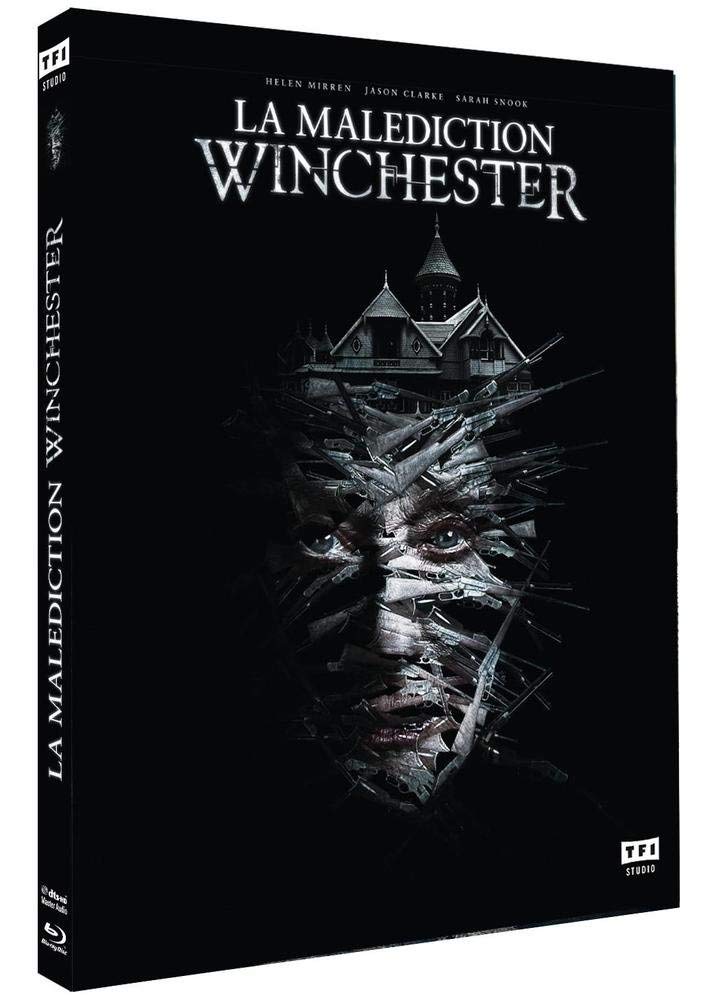
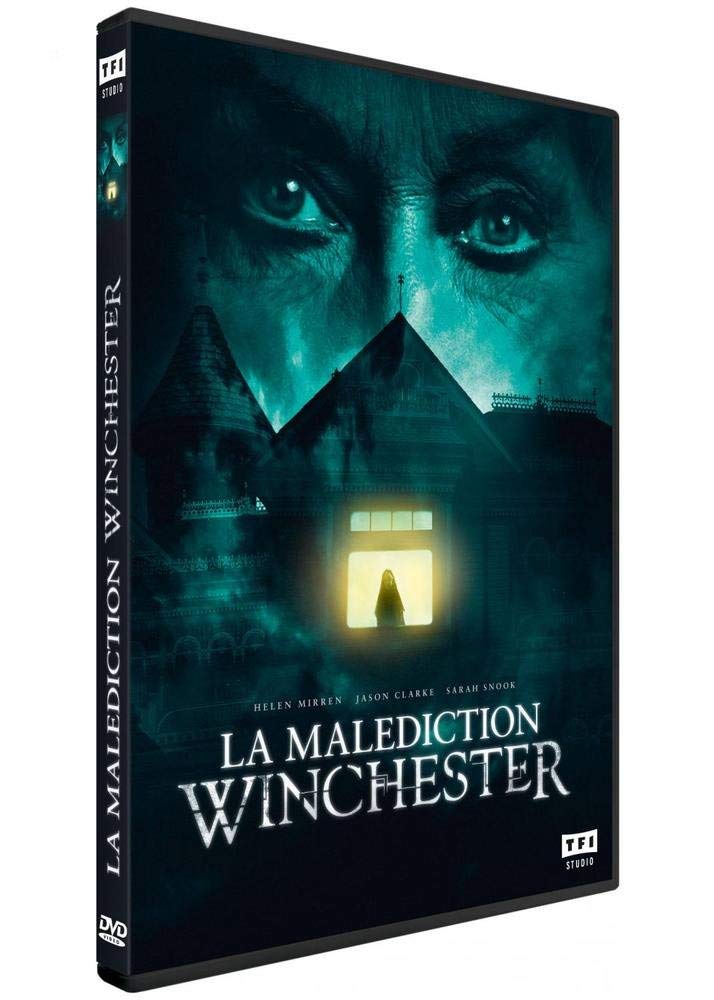
Cette édition s’accompagne d’un seul supplément, un making of (22’) classique, mais assez complet, revenant sur tous les aspects du tournage. La véritable histoire de Sarah Winchester est évidemment au centre de ce documentaire. Tous les comédiens, les réalisateurs, les producteurs, les responsables des départements costumes, décors (très impressionnants) et maquillages, interviennent à tour de rôle, tandis que des images du plateau viennent illustrer l’ensemble.

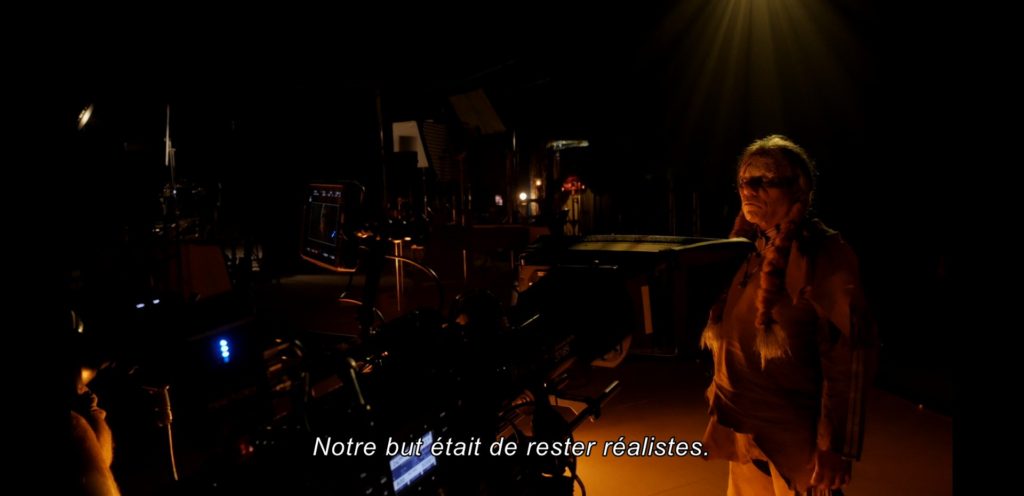












L’Image et le son
TF1 Studio soigne son master HD. Les contrastes sont d’une densité rarement démentie, y compris sur les très nombreuses séquences sombres, avec une image sans cesse affûtée. Le piqué est acéré, les gros plans riches, les contrastes denses et la colorimétrie reste chatoyante. Les détails sont légion aux quatre coins du cadre large et la copie restitue les volontés artistiques du chef opérateur Ben Nott. Ce Blu-ray offre d’excellentes conditions pour revoir le film des frères Spierig et profiter de la superbe photographie. L’apport HD sur ce titre est évidemment indispensable.

Les deux versions DTS-HD Master Audio 5.1 font quasiment match nul en ce qui concerne la délivrance des ambiances sur les enceintes latérales, la restitution des dialogues et la balance frontale. Le spectateur est littéralement plongé dans ce quasi- huis clos, la spatialisation reste solide tout du long et le caisson de basses est utilisé à bon escient comme lors du tremblement de terre. Sans surprise, la version originale l’emporte de peu sur l’homogénéité et la fluidité acoustique, tandis que la piste française a tendance à mettre les voix un peu trop en avant. L’éditeur joint également les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant.

 Crédits images : © Splendid Film / Vértice Cine / TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr
Crédits images : © Splendid Film / Vértice Cine / TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

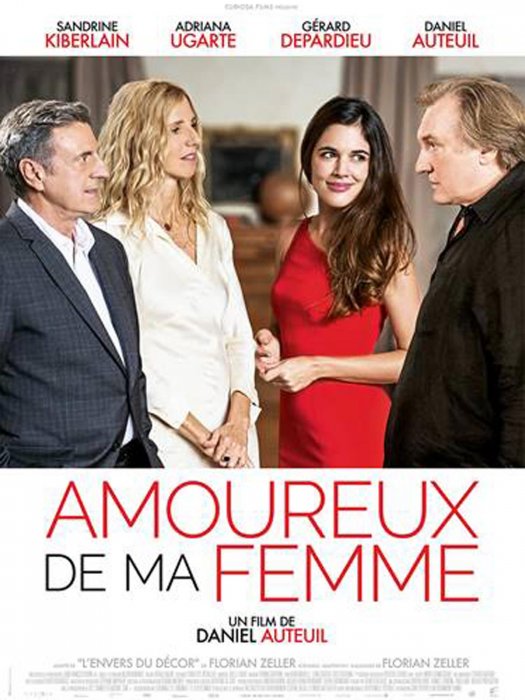













 Crédits images : ©
Crédits images : © 









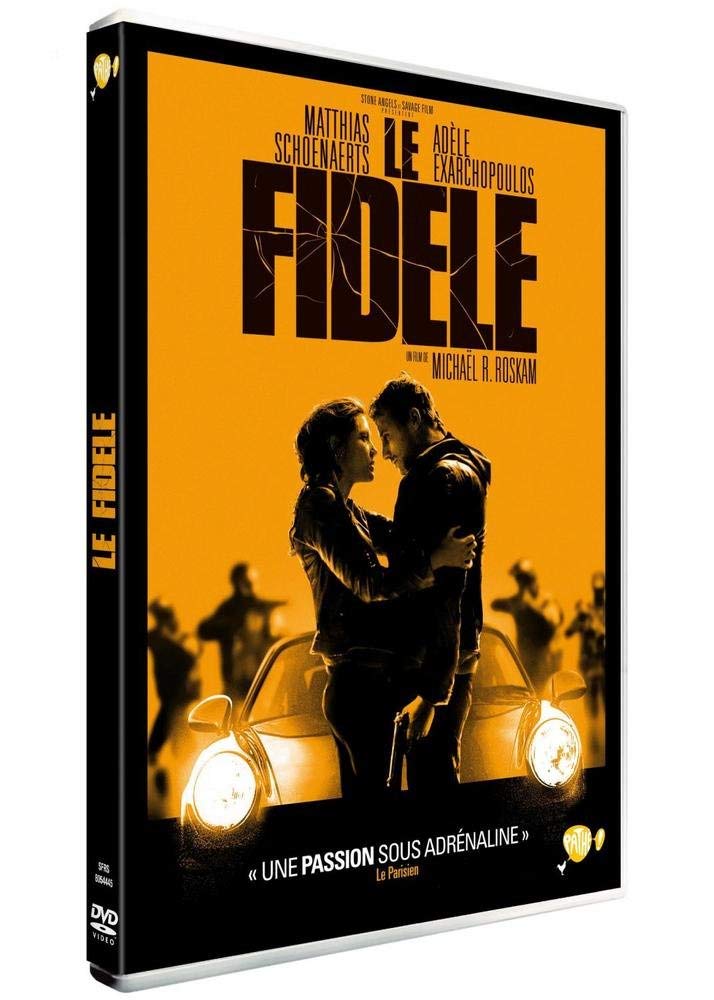







 Crédits images : ©
Crédits images : ©





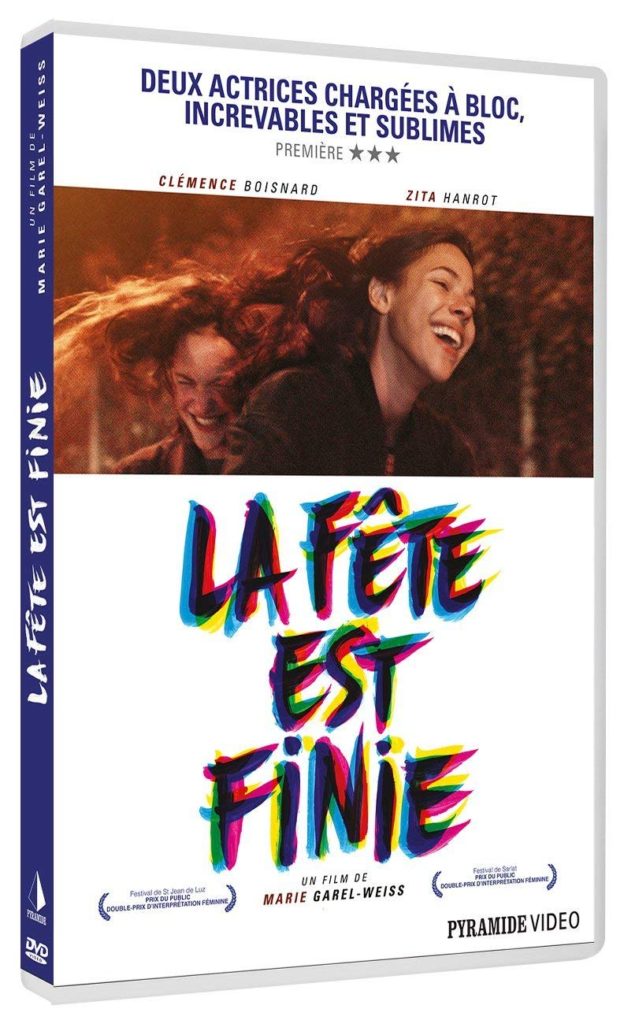






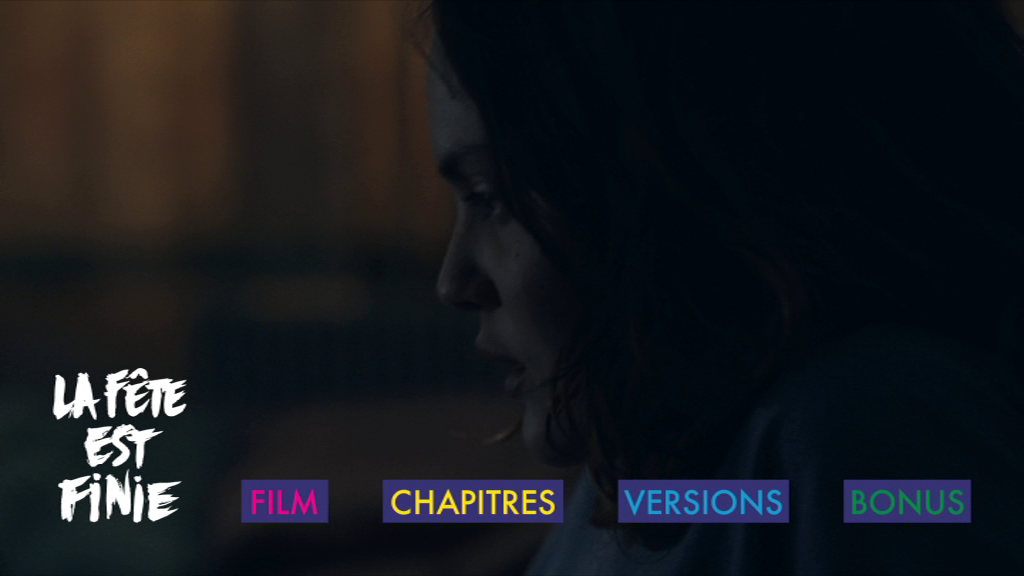



 Crédits images : ©
Crédits images : ©





























 Crédits images : ©
Crédits images : ©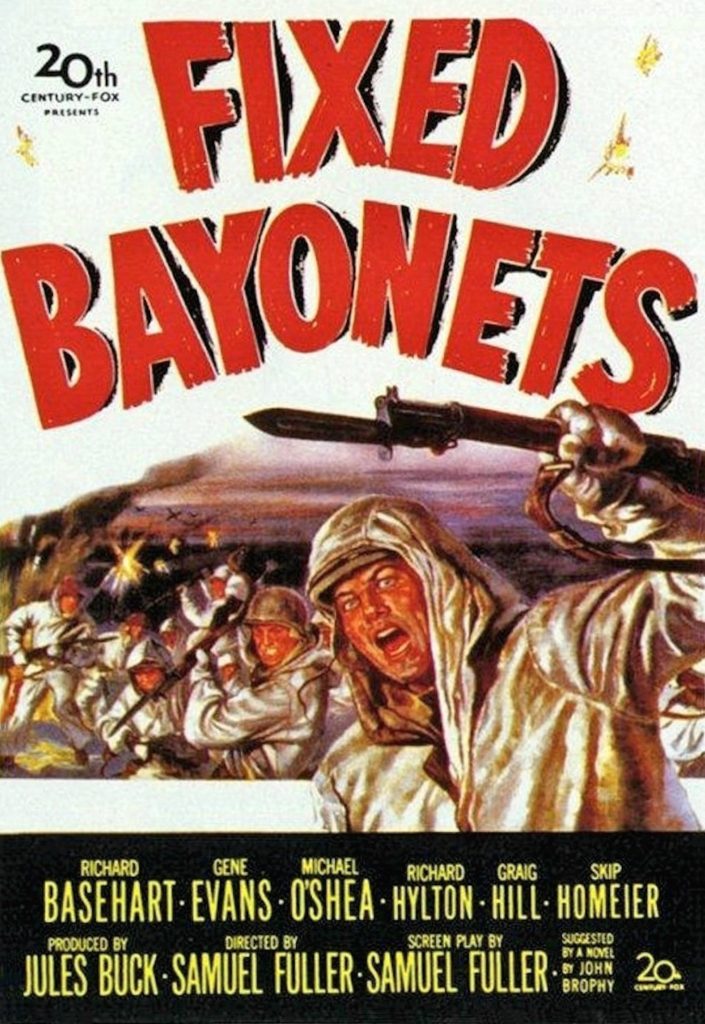





















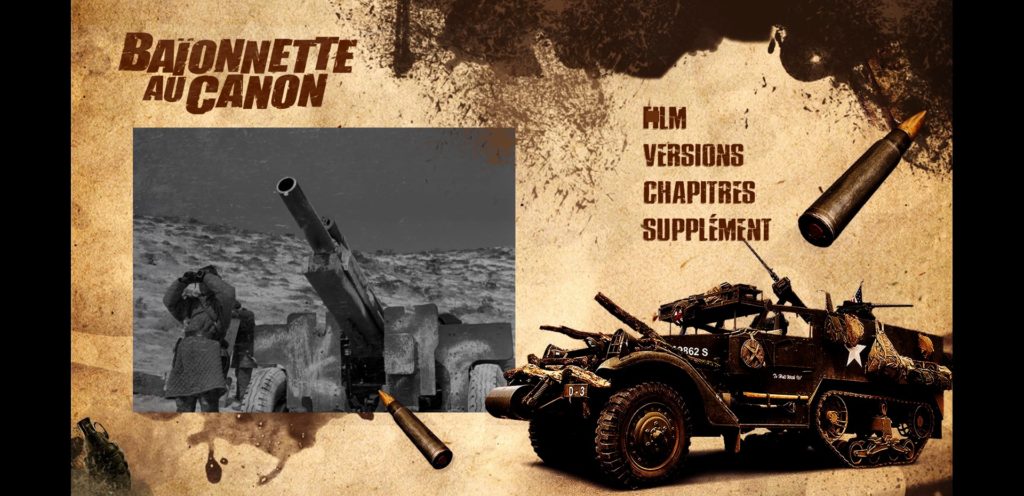

 Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr
Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr






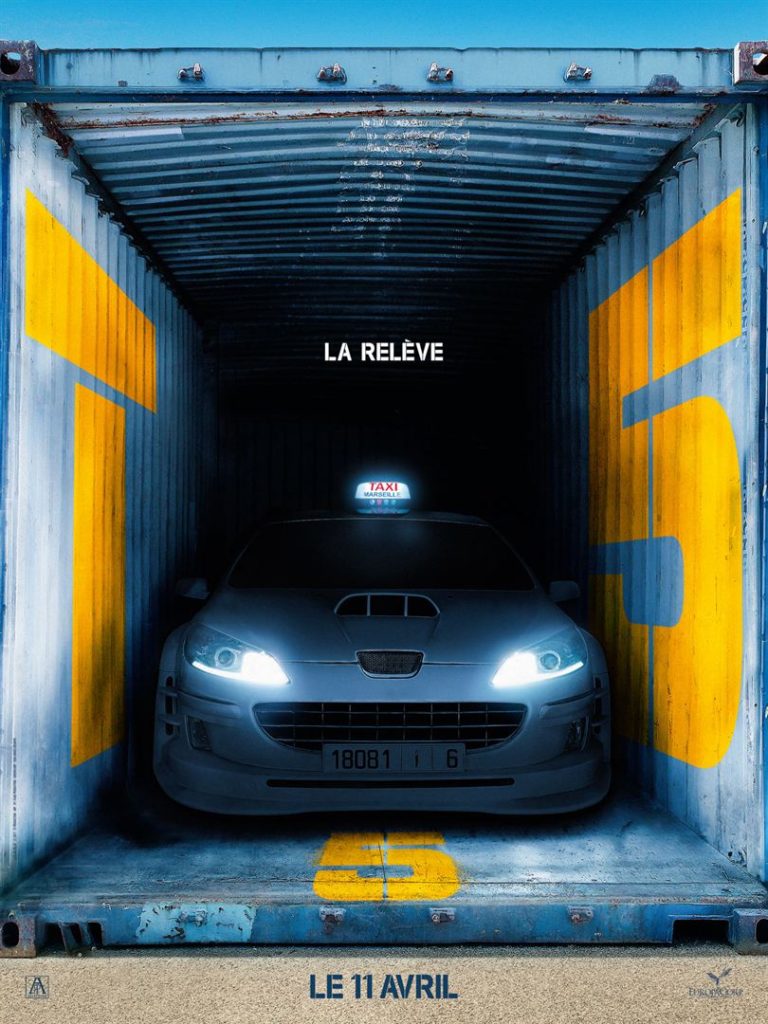


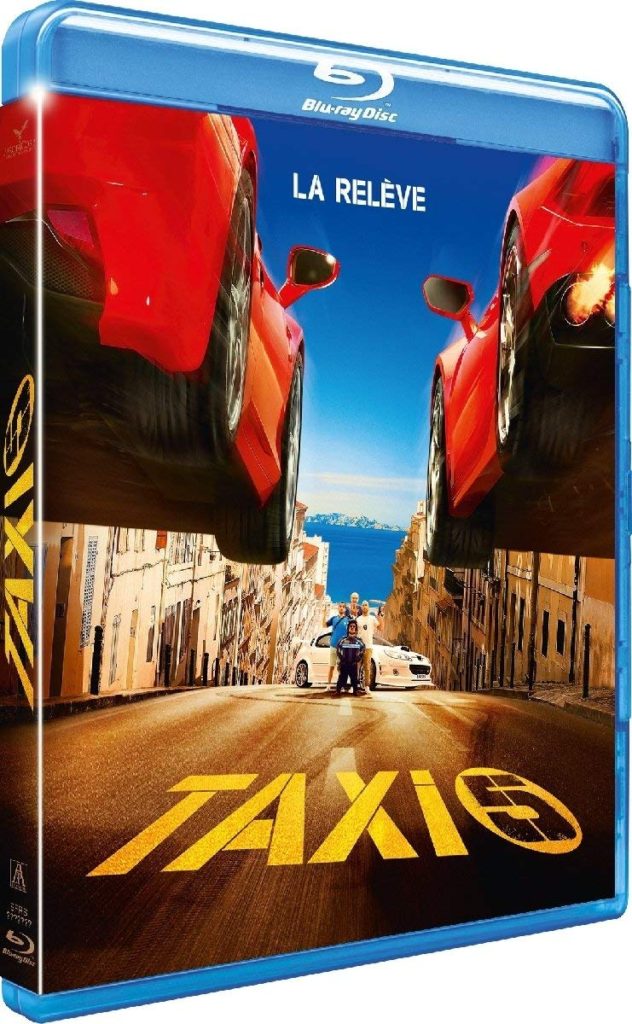














 Crédits images : ©
Crédits images : ©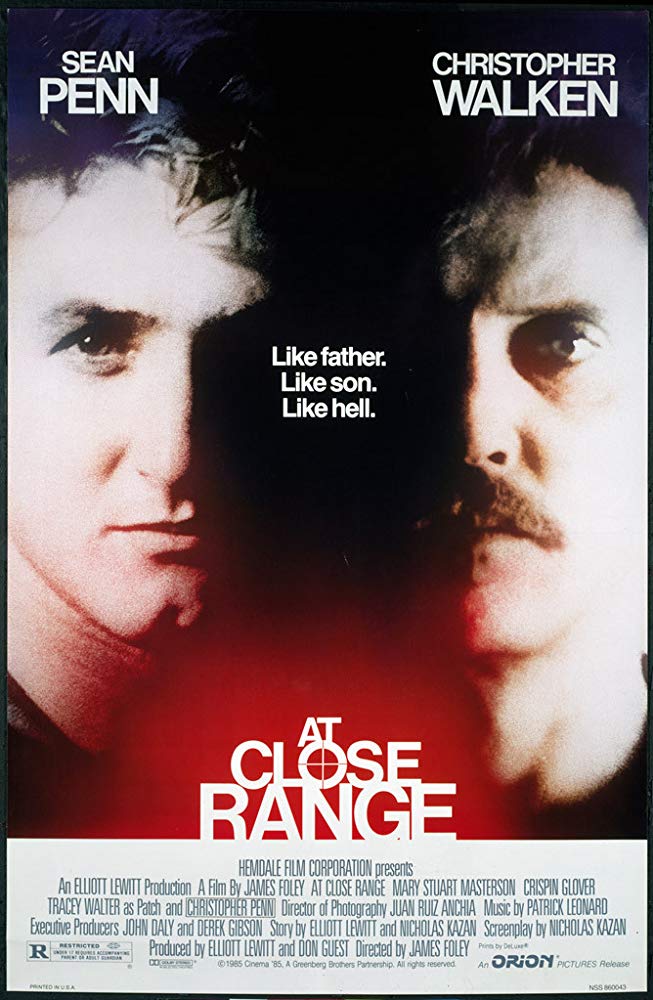























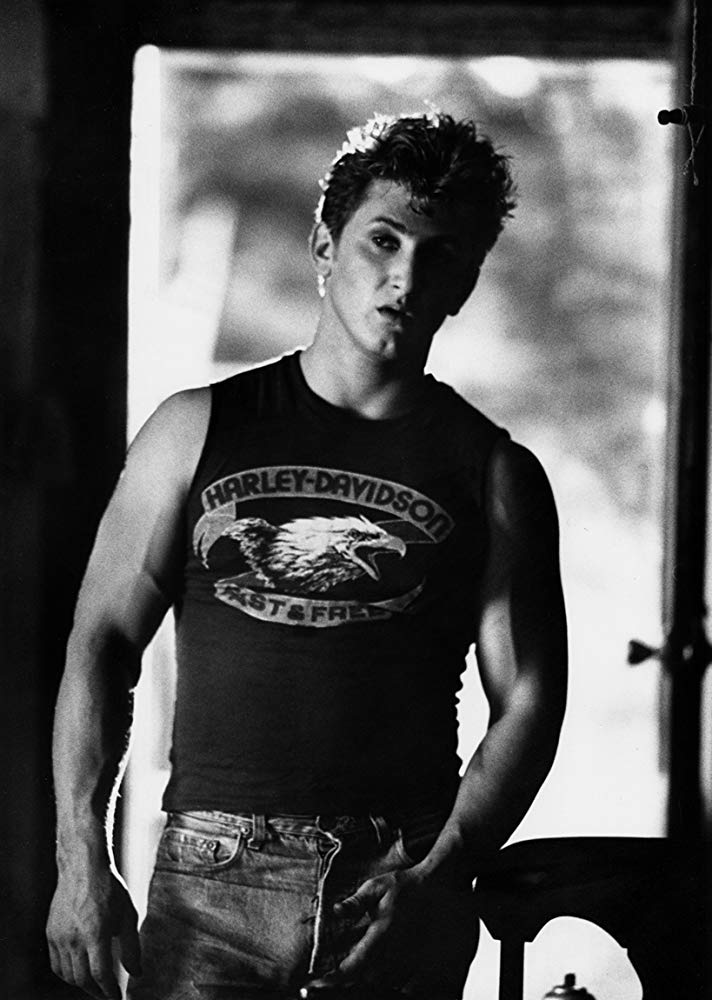 Crédits images : ©
Crédits images : © 


























 Crédits images : ©
Crédits images : ©





























